Contact
183 Rue NapoléonSept-Îles G4R4R7
Canada
418-962-0327
https://www.goexploria.com/company/12887/pourvoirie-moisie-nipissis-inc



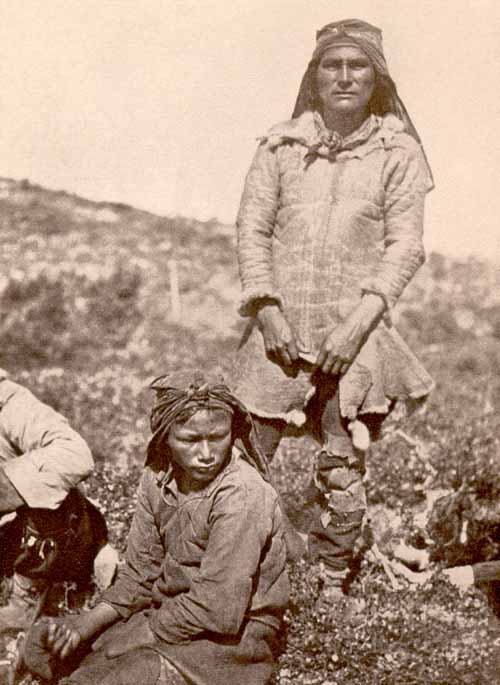


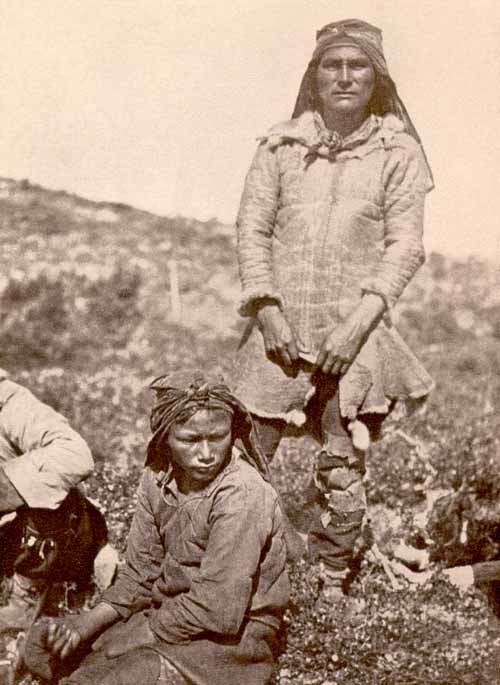

Catégories |
Résidents |
Non-résidents |
|---|---|---|
Annuel moins de 65 ans |
26,24 $ |
93,90 $ |
Annuel 65 ans et plus |
20,81 $ |
Non offert * |
7 jours consécutifs |
Non offert |
56,59 $ |
3 jours consécutifs |
15,02 $ |
37,64 $ |
1 jour |
Non offert |
21,95 $ |
Remise à l’eau obligatoire ** |
15,02 $ |
36,81 $ |
Catégories |
Résidents |
Non-résidents |
|---|---|---|
Pêche à la lotte au lac Saint-Jean * |
26,26 $ |
84,55 $ |
Permis de remplacement |
7,01 $ |
7,01 $ |
Catégories |
Résidents |
Non-résidents |
|---|---|---|
Annuel |
58,65 $ |
188,15 $ |
3 jours consécutifs* |
25,56 $ |
50,13 $ |
Remise à l’eau obligatoire |
25,56 $ |
50,13 $ |
Pêcheur souhaitant bénéficier du permis |
Permis de pêche sportive (sauf au saumon atlantique) et permis de pêche à la lotte |
Permis de pêche sportive au saumon atlantique |
|---|---|---|
Votre conjoint ou conjointe |
Oui, s'il ou elle est en votre présence ou en possession de votre permis |
Non |
Vos enfants de moins de 18 ans ou ceux de votre conjoint ou conjointe |
Oui, s'ils sont en votre présence ou en possession de votre permis |
Oui, s’ils pêchent sous votre surveillance ou celle de votre conjoint ou conjointe qui est en possession de votre permis |
Vos enfants (ou ceux de votre conjoint ou conjointe) qui sont âgés de 18 à 24 ans et qui sont titulaires d’une carte d’étudiant valide |
Oui, s’ils sont en possession de votre permis ET de leur carte d’étudiant valide |
Oui, s’ils sont en possession de votre permis ET de leur carte d’étudiant valide |
Toute personne âgée de moins de 18 ans |
Oui, si elle pêche sous votre surveillance ou celle de votre conjoint ou conjointe |
Oui, si elle pêche sous votre surveillance ou celle de votre conjoint ou conjointe |
Tout étudiant âgé de 18 à 24 ans en possession de sa carte d’étudiant valide |
Oui, s'il pêche sous votre surveillance ou celle de votre conjoint ou conjointe |
Oui, si elle pêche sous votre surveillance ou celle de votre conjoint ou conjointe |



| Activité | Catégorie |
|---|---|
| Pourvoiries | Chasse et pêche |